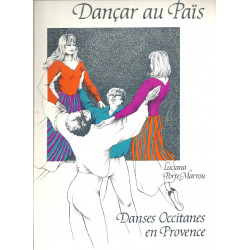Élément(s) ajouté(s) récemment
Aucun produit
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Histoire - Etudes
- Sélection du moment
- Livres
- Musique
- Videos - DVD
- Objets
- Revues, Journaux
Liens à visiter
L'école française et l'occitan. Le sourd et le bègue - Philippe Martel
L-9782367811918
Neuf
2 Eléments
En stock
15,00 €
L'école française et l'occitan. Le sourd et le bègue - Ce livre de Philippe Martel réunit et analyse certains épisodes de l'histoire de l'exclusion des langues de France dans le système éducatif français depuis le XIXe siècle.Presses universitaires de la Méditerranée.
Fiche de données
| Type | Broché |
| Année | 2012 |
| Langue | Français |
| Pages | 196 |
| Format | 16 x 24 cm |
| Distributeur | Presses universitaires de la Méditerranée – PULM |
| ISBN | 978-2-84269-801-0 - 978-2-36781-191-8 |
| ISSN | 1962-1116 |
Plus d'infos
L'école française et l'occitan. Le sourd et le bègue - Philippe Martel
« Le français sera seul en usage dans l’école. » Cet alexandrin boiteux, article 14 du règlement type des écoles de Jules Ferry, décrétait, sans le dire ouvertement, l’exclusion totale des langues de France, dont l’occitan. Et pourtant, plus d’un siècle plus tard, et après des décennies de revendications, ces langues ont une (toute petite) place dans le système éducatif français.
Les articles ici réunis analysent certains épisodes de cette histoire depuis le XIXe siècle. Ils n’affirment pas (avec fureur) que l’école française a persécuté les langues de France, car tous les maîtres n’ont pas été forcément répressifs. Ils n’affirment pas davantage (avec attendrissement) que les hussards de la République, épris de local et amoureux de leur petite patrie, n’ont rien fait contre les langues de France, qui auraient donc décliné toutes seules, car ce n’est pas si simple. Et c’est de la complexité et des contradictions de tout un processus que l’on essayera de rendre compte ici, à partir du cas occitan.
(Réimpression à l'identique de la première édition de 2007).
Collection Études occitanes n°2, Presses universitaires de la Méditerranée.
Sommaire:
Préface de Robert Lafont: En France, le divers vaut l’un
Avant-propos
1. Le « patois à l’école » ? Retour sur un débat (XIXe-XXe siècles)
1.1 Le temps du refus fleuri
1.2 Le temps des concessions maussades
1.3 Le temps du verrouillage « citoyen »
2. L’impossible politique linguistique occitaniste
3. Les pédagogues et les « patois » sous la Troisième République
3.1 Les chiens de garde
3.2 Pour une pédagogie bilingue ?
4. Les félibres, leur langue, et l’école : à propos d’un débat de 1911
5. L’école de la IIIe République et l’occitan
[2] Vu d’en bas...
6. Travail, famille, patois : Vichy et l’enseignement de l’occitan, apparences et réalités
6.1 1940 : le temps de la divine surprise
6.2 Le temps passe
6.3 Sur le terrain
7. Autour de la loi Deixonne
7.1 Un peu de préhistoire
7.1.1 Textes et contre-textes
7.2 Course d’obstacles dans les palais nationaux
7.3 Pour ou contre
8. Dauzat et la revendication occitane : une certaine distance
8.1 Avant Deixonne : le temps des convictions tranquilles
8.1.1 Les « patois » se meurent, et c’est plutôt une bonne nouvelle
8.1.2 Les efforts des défenseurs des patois ne peuvent rien changer à leur destin. Là encore, le ton est donné dès 1906
8.2 Dauzat contre Deixonne : la guerre des langues
8.3 Dauzat et les félibres, ou le sens commun
Les personnages principaux de cette histoire
Bibliographie sommaire
Article critique sur le livre:
Philippe Martel, chercheur au C.N.R.S. et chargé de cours à l’université de Montpellier, est un historien reconnu du fait occitan, « historien de l’Occitanie » comme l’indique dans sa préface Robert Lafont — qui ne manque pas de souligner d’entrée la difficulté de la posture dans le champ universitaire français (et spécifiquement français !) contemporain. Le temps semble passé, en effet, où un Emmanuel Le Roy Ladurie faisait rayonner le terme à partir de son Montaillou village occitan (1975), où l’Institut d’études occitanes faisait paraître chez Hachette une volumineuse Histoire de l’Occitanie (1979) sous la direction des deux Robert : le même Lafont et le regretté démographe toulousain Armengaud, vaste entreprise à laquelle Martel apporta toute sa contribution (soit le quart d’un ouvrage dont on aimerait bien qu’il fût réédité !). On se réjouira donc de l’initiative des Presses universitaires de la Méditerranée de donner à (re)lire un ensemble d’articles ou de communications de colloques conçus pour l’essentiel dans la décennie 1990 et devenus d’accès difficile aujourd’hui.
Les récents débats du printemps 2008 sur une éventuelle mention des « langues régionales » dans la constitution révisée (et à quelle place : de l’article 1 — langues patrimoniales — à l’article 74 — langues de la décentralisation, en sautant l’article 2 sur la langue nationale) montrent à l’évidence toute l’acuité des travaux de Martel. N’a-t-on pas entendu alors, exemple parmi d’autres, dans une émission dominicale de France Culture consécutive à la messe un éminent chroniqueur du Nouvel Observateur lier sans autres commentaires (superflus ?) la dimension patrimoniale des dites langues et l’ancienne Révolution nationale chère au maréchal Pétain ? CQFD ! C’est à cette délicate question, fortement marquée de « pré-jugés », que Martel consacre au demeurant le 6e article de son livre, situant l’enseignement de l’occitan dans un contexte politique d’ensemble et cherchant par delà les « apparences », on a envie d’écrire les fantasmes parfois, les strictes « réalités » : ainsi, si l’arrêté du 27 décembre 1941 dû au Secrétaire d’Etat à l’Éducation nationale et à la Jeunesse Jérôme Carcopino est bien le premier texte officiel concernant l’enseignement des « langues dialectales » dans le primaire, il y eut loin de la coupe (félibréenne, si l’on ose dire !) aux lèvres... Si Carcopino abolit au même moment les « devoirs envers Dieu » dans l’école républicaine (pour les remplacer par le « culte des Héros et des Saints », il est vrai) — ce qui est tout à fait ignoré de nos jours —, il n’eut guère les moyens d’imposer, dans son bref passage aux affaires, quoi que ce soit. Il faudrait chercher les débuts de réalisations concrètes du côté d’associations telles que le Collège d’Occitanie, sis à Toulouse et dirigé par l’abbé Salvat, ou des Grelhs roergats de l’instituteur-écrivain Enric Mouly, curieusement non mentionnés par Martel : ils n’ont pas, grosso modo, à rougir de leur travail (cf. le 1er Congrès du Collège d’Occitanie, sis alors à Rodez ; le Congrès de phonétique occitane, sis à Toulouse).
Le propos de Philippe Martel n’en est pas moins complet, construisant un continuum théorique et une mise en perspective historique fort probants. Partant d’une analyse générale sur « le patois à l’école » (premier article), Martel expose les avatars des oppositions sur deux siècles (xixe-xxe siècles) : du « refus poli » au « verrouillage citoyen », en passant par les « concessions maussades ». La figure du « refus poli » fut celle de la IIIe République où les « Méridionaux » tinrent le haut du pavé officiel et même le char de l’État : pour autant nombreux furent les « faux amis », tels Leygues ou Daladier, prêts à défendre les « petites patries » mais surtout pas l’enseignement de la langue d’oc, fût-elle chère à leurs oreilles (Mistral faisait quand même remarquer en 1898 qu’on enseignait l’anglais, l’allemand... et même l’arabe en Algérie). Puis, sous les coups répétés du « bègue » (l’occitan), vint de la part du « sourd » (l’État) le temps des « concessions maussades », dont la loi Deixonne (1951) représentera l’expression majeure. Aujourd’hui la réthorique de la « citoyenneté » tend à restreindre autant que faire se peut tout ce qui pourrait menacer la France via le communautarisme, par exemple la ratification de la Charte européenne contre laquelle un front éminemment composite se déploie de l’extrême-droite à l’extrême-gauche en passant par le gaullisme statufié et le socialisme cocorico... Les arguments changent, dans leur expression, au fil du temps, non dans leur esprit.
À partir de cette analyse princeps, Ph. Martel peut nous présenter des variations. En premier, la politique de la IIIe République et de ses pédagogues (3e et 5e articles) qui n’est pas toujours faite d’oppositions brutales, mais parfois de compréhension limitée : l’occitan, connu des élèves, peut à l’occasion les aider à mieux orthographier le français (exemple rabâché : le participe passé et sa terminaison). Ainsi, en 1872, le professeur au Collège de France Michel Bréal n’est pas du tout favorable à « l’enseignement des patois », mais il n’exclut pas que de bons auteurs lus (Mistral, Jasmin, etc.) soient à l’occasion dans les écoles — car, pour lui, selon une formule frappante, l’école doit « tenir au sol » sous peine d’être inefficace (les prêtres, dit le même Bréal, le savent fort bien !). C’est finalement là la position des pédagogues « pro-patois » sous Vichy, mais aussi celle d’un Célestin Freinet qui ne fut pas du tout de ce bord politique ! La Libération verra se développer, dans le même esprit, la « pédagogie du milieu ».
Pour autant, les oppositions furent dans l’ensemble vives (un euphémisme !). Martel nous le montre sur deux terrains. Celui du débat parlementaire des années 1948-1951 : ainsi, le vote de la loi Deixonne, première loi républicaine de tolérance linguistique, ne fut pas du tout une partie de plaisir (ledit Deixonne, député socialiste du Tarn, n’étant pas au demeurant un des plus grands défenseurs de la Cause, comme eût dit Mistral en son temps (article 7). De même, dans le champ scientifique, le linguiste Albert Dauzat (1877-1955), originaire de la Creuse, s’affirma-t-il comme un adversaire résolu de la proposition de loi (article 8), parmi bien d’autres intellectuels et d’honorables institutions toujours en course aujourd’hui (l’Académie française, le Sénat...). Pour autant, le camp des défenseurs de l’enseignement de la langue d’oc ne fut pas sans défauts. Martel aborde ce point par ses articles 2 et 4. Ainsi parle-t-il d’une « impossible politique linguistique occitaniste » (et rien de moins !) en général et d’un déficit du Félibrige à l’occasion d’une campagne et d’un débat interne en 1911 (cf. le marquis de Villeneuve-Esclapon et sa revue Occitania) : hier comme aujourd’hui, le mouvement semble paralysé entre une option maximaliste (l’occitan rétabli dans toute sa dignité nationale, voire étatique) et une option minimaliste faite de bricolage au fil des circonstances (« l’occitan comme « plus » culturel offert par un système culturel allogène »).
Le livre se clôt par une « présentation des principaux personnages » connus (Mistral, Perbosc) ou moins connus (Berthaud, Gaidoz) : très ramassée, elle est bienvenue. Une bibliographie de deux pages est présentée en fin d’ouvrage ; elle va à l’essentiel mais n’a pas été vraiment actualisée (la référence la plus récente est de 2003) et certains oublis sans doute involontaires, dans la décennie 1990 même, interrogent : pourquoi mentionner Chanet, L’école républicaine et les petites patries, 1996, et non Thiesse, Ils apprenaient la France, 1997 ? Cette ultime remarque n’enlève rien à la qualité d’ensemble du livre dont on ne peut que recommander une lecture attentive (comme pour d’autres articles de l’auteur, non repris ici mais mentionnés dans la bibliographie).
En conclusion donc : une excellente initiative de Philippe Martel, chercheur et acteur de l’enseignement de l’occitan, et des Presses universitaires de la Méditerranée.
Hervé Terral, « Philippe Martel, L’école française et l’occitan. Le sourd et le bègue », Lengas [En ligne], 65 | 2009, mis en ligne le 05 janvier 2016, consulté le 19 mars 2018. URL : http://journals.openedition.org/lengas/916
Préface de Robert Lafont. En France, le divers vaut l’un
Philippe Martel est historien. Historien de l’Occitanie, ce qui revient à se ranger à une organisation et définition des sociétés qui ont pu paraître surprenantes ou scandaleusement arbitraires, idéologiques pour tout dire, lorsque des gens de métier comme lui les ont inscrites en titre de leurs travaux. Je me souviens d’un Congrès de maîtres de la discipline universitaire qui semblait avoir pour fonction de s’en garder comme d’une idée du diable. C’était à Montpellier, lieu qui rendait le délit évident. La monumentale Histoire d’Occitanie, où Martel avait été le médiéviste remarqué, venait de paraître chez Hachette. Il fallait d’urgence effacer l’actualité.
On alla donc vers la conclusion qu’il ne pouvait y avoir d’histoire régionale en France que celle des aspects régionaux de l’histoire nationale. Ce qui, bien sûr, n’avait rien d’idéologique ni d’arbitraire. Il ne fut pas nécessaire de prononcer le nom d’Occitanie, et l’on s’en priva. Écrasée entre le monument marmoréen de la Nation et la masse des travaux qui prennent pour objet ses provinces ou de plus modernes découpages de son territoire, elle disparaissait avant d’être prononcée, inexistante par substance. On négligea de cette façon d’évaluer ce qu’il y avait de ferme et de recommandable suivant la tradition dans les méthodes et les découvertes de ceux qui s’étaient groupés sous un tel risque, dont Martel lui-même, tous aussi spécialistes diplômés que leurs zoïles silencieux. On se protégea de la tentation de voir, à la lumière d’un éclairage qu’on n’attendait pas, ce qu’on n’avait jamais su voir.
J’assistais aux débats comme coupable d’avoir, avec mon ami André Armengaud, allumé cette lanterne, et je me disais qu’il y avait bien dans cette cérémonie d’exorcisme une accusation capitale autant qu’implicite, et qui n’était pas contre l’innommable Occitanie. L’exorcisme n’a jamais rien prouvé sur la responsabilité du diable dans les délires, mais tout sur ceux de l’exorciste. J’en vins ainsi à penser qu’on se donnait beaucoup de mal en ce débat unanime pour assurer dans sa pérennité et son intouchabilité le concept de France et faire le vide autour de lui. Je me mis ainsi à prendre les discours tenus à l’envers de leur intention et de me faire de la France un certain portrait caché sous la louange rituelle.
La même envie m’a saisi en lisant les articles de Martel ici réunis. Martel s’est fait une seconde vocation d’historien des pièces et documents. D’une sorte de compulseur des preuves. Sa thèse de doctorat allait dans ce sens : en exhumant des archives ce que Paris avait dit de Mistral et des félibres, il démolissait la légende bâtie à grands coups de Lamartine mal compris d’un héros du Midi accueilli par l’admiration du Nord. Les réserves reprenaient leur relief et la perfide insinuation perçait au jour : « C’est bon, vous avez du génie, mais que n’écrivez-vous pas comme nous la langue de la Nation ! ». Une estocade sous les palmes.
À lire le dossier réuni aujourd’hui sur la perception française des « langues régionales », où dominent les déclarations officielles et ministérielles, on peut jouer le jeu de la désoccultation. « Vous êtes charmants, les parlers de France, juteux de sève rurale, porteurs de nos émotions d’enfance, parés des charmes de nos vieillards si aimablement chevrotants, mais que ne crevez-vous ! Voyons, soyons sérieux : le Progrès, la Nation moderne, une et indivisible à en frémir d’orgueil, le vigoureux sentiment que l’inéluctable est juste ! »
Nous eûmes récemment, Occitans et Bretons, Basques et Flamands, Morvandiaux et Poitevins, Haut-Limousins et Séquanes maritimes, une fort belle célébration en ce genre à la Villette près de la Grand Ville, et dûmes essuyer la déclaration liminaire d’un Ministre : « La question des langues régionales est une question de souffrance. » Nous eûmes aussitôt honte de ne pas souffrir, mais d’espérer selon ce qui nous avait été promis. Naturellement, rien de positif, qui pût retenir nos larmes éventuelles, ne sortit de l’aventure. Les ministères refermèrent leurs portes, les ministres permutèrent et le linguiste qui nous avait conviés au nom d’un plan de sauvetage que nous avions élaboré avec lui, s’en alla enseigner la francophonie aux Amériques.
D’incidents de ce genre, Martel, qui est un chercheur impeccable, pratiquant l’impartialité d’un juge honnête sans apparat, en signale un bon nombre, et en dévoile que nous ne connaissions pas, car il a eu accès à des archives peu consultées avant lui. On ne trouvera pas chez lui d’indignation pathétique ni de dénonciation facile. Tout au plus, en parcourant son témoignage, percevra-t-on le fil d’ironie qui lui est particulier : la plus agréable des gloses, car cet historien est un écrivain et aussi un homme d’esprit. L’ironie dévidée, les preuves examinées, on pourra se faire, comme on dit, une idée.
Mais quelle idée ? Je crains bien que ce soit la mienne, celle qui me vint au for intérieur, le jour où j’écoutais sans dire mot le discours d’unanimité et d’unité de mes éloquents collègues de l’Histoire de France. Car il y a une Histoire de France, évidente et redoutable. Et puisque j’ai pris la liberté de préfacer le dossier si bien ficelé par Martel, cette histoire, je vais la conter à ma manière. Je jouerai peut-être les avocats, on me pardonnera les effets de manches.
Cette histoire, quand commence-t-elle ? J’ai appris à l’école dans un fond de campagne occitane d’un maître qui était descendu vers nous, je crois du Haut-Rhin, qu’elle naît au temps des Gaulois, ces ancêtres qui parlaient celte comme des bas Bretons, avaient le cheveu blond et les yeux bleus comme un regard d’Alsacien repenti.. J’aurais pu admettre en la même école qu’elle naquit un peu plus tard avec le Franc Clovis, qui ne jurait qu’en germanique, comme qui dirait en allemand, et jura sa foi catholique à Clotilde la Burgonde. Ou bien avec Hugues Capet qui monta avec secours ecclésiastique romain sur le trône de l’Empereur Charles le Salique. Avec Hugues, c’en était fait, le territoire était consacré. Il ne restait plus qu’à le conquérir sur les provinces. Il devait s’appeler France et parler français, un latin de faux clerc que les Serments de Strassburg avaient enregistré.
Pour parfaire la France, il y eut ensuite quarante rois, Capétiens, Valois et Bourbons qui avaient tous une furieuse gloutonnerie de langues. L’un, qui s’appelait Françoys, fit la guerre en Italie pour la perdre, et à Villers- Cotterêts, un lieu où il chassait d’ordinaire le cerf, chassa de l’écrit public tout autre langage que le sien, françoys bien sûr. Il y en eut un autre qui pour garder les imparfaits du subjonctif des idiomes provinciaux fonda une Académie, françoise se devait. Celui-là eut un fils qui rayonna soleil sur l’Europe, l’épuisa et son royaume aussi dans la guerre, conquit une Comté espagnole qui ne fut plus franche et pendit force Bretons du bas à bonnets rouges. Sous lui, les écrivains eurent les meilleures plumes françoises et firent des révérences à Versailles. Le dernier, qui ne valait pas un louis, épousa une Autrichienne qui le trompait dans les devoirs de lit dont il s’acquittait si péniblement, et perdit la tête avec la couronne.
Mécontent de cette France que les souverains avaient faite, le peuple soudain souverain s’en fit une autre en liberté nationale, égalité de droits et fraternité de classes. On parla désormais beaucoup de Nation. Le françois que peu de sujets du roi savaient devint le français national que tous devaient savoir. Sur ce survint un petit caporal parlant la lingua corsa, qui hissa sa petite taille jusqu’à devenir grand Empereur des Français et, à ce titre, se mit à dévorer l’Europe. Après sa chute dans une plaine flamande, il y eut dans une France réduite retour d’un Louis, r’Empire pour Cent jours, remonarques, révolutions et républiques, r’Empire bis, et République éternelle par incident de scrutin. Pendant que les Prussiens campaient devant Paris, que les ouvriers de la Capitale se révoltaient contre le Capital, l’unité de la Nation se dessina alors. Elle bredouillait encore en ses jargons, elle devait parler comme on parlait au Palais Royal. On l’y mit.
Au fond jusqu’alors impénétrable des départements, les maîtres d’école se mirent à l’œuvre : les enfants de crottés se firent propres et ânonnèrent la langue de Racine en perdant les leurs. Ils surent qu’ils descendaient tous, même en Algérie, de Vercingétorix, de Charlemagne le Franc qui les distribuait en bons et mauvais élèves de France, ils apprirent à garder la tête froide quand elle s’échauffait à la gloire de tous ces rois qui avaient fait les angles de l’Hexagone, à pousser la charge avec le Corse qui les vendettait de toute faiblesse. Ils aimèrent la France comme une mère qui les amenait tendrement au combat contre les Bicots mal lavés, contre le Boche qui pue, mieux que le grand-père qui s’obstinait à patoiser en ses sabots. On les envoya donc mourir en héros, en bel ensemble et en masse sur l’Ardenne, dans un salmis de nègres rameutés d’Afrique pour défendre les trois couleurs. Ils savaient la France par cœur. Ils n’avaient jamais rien su de l’histoire de leurs petits pays, du pourquoi et du non-devenir de ses révoltes de jadis. Ils commençaient à ne plus rien savoir de leur langage natif qui ne leur avait valu que des coups de règle sur les doigts.
J’arrête là l’Histoire de France. De toute façon elle est close dans la tête des Français, verrouillée de certitude. Elle se reconduit reluisante à travers les incidents politiques et belliques. Qui douterait aujourd’hui en France que le français est la plus belle des langues ? Qui douterait que la Nation est grande, et qu’on lui doit tout, y compris de se couper la langue pour mieux causer la sienne ? Des siècles ont préparé cet accord de tout un chacun avec le sentiment commun.
Avocat, je change donc de barre. Je prends l’autre parti. Celui de la diversité d’un héritage. Comment ? vous avez dit diversité ? Où la trouvez-vous, sinon dans l’admirable gamme de nos paysages ? En Armorique ? C’est vrai, on y parla longtemps une langue tordue, où, quand on demandait pain et vin, on comprenait baragouin. C’est presque fini maintenant, pour l’unité de la France. Au Pays basque, où, s’il n’y avait pas l’Île aux Faisans sur la Bidassoa, on serait encore en Espagne à tirer des coups de feu ? En Rroussillon où on roule les erres comme des cailloux dans la Têt ? En Alsace, où il a fallu des régiments d’instituteurs pour que les cigognes sachent sprechen franzõse ? En Provence, té, peuchère ! où on galège trop pour comprendre la noble beauté du parler pointu ? Où, dites-vous ? En Oxytanie ? Ça n’existe pas. Que me racontez-vous ? Que ces foutus cathares ont inventé les troubadours, qui ont donné la poésie d’amour à l’Europe. L’amour, c’est gaulois, c’est français. On ne baise bien, parlant de poésie, qu’à Montparnasse. L’accent, je vous l’accorde. C’est le charme de la Province. Mais la langue, non ! La langue est une comme la République. Il n’est bon bec que de Paris. Fermez le vôtre.
L’Avocat n’a pas pour tâche de répéter les sottises de la partie adverse. Je me drape donc dans la vérité que je défens, que j’ai désapprise de l’École, qui se date du temps où de France il n’y avait mie jusqu’à ce jour d’hui où il n’y en aurait que trop. Dans une préhistoire insondable j’irai chercher la langue basque, ou euskara, qui dame à toute l’Europe le pion d’antiquité, et qui a survécu jusqu’à nous mettre les mômes en Ikastola. Dans une péninsule où les druides coupaient jadis le gui-l’an-neuf, je vais trouver les cousins des Gallois, Corniques et autres Irlandais qui ont eu naguère le toupet de se faire bardes sur guitares et de revendiquer le Brezhoneg ar Skol. En Corse, l’île de beauté pour blasés du Ve arrondissement, où l’on ne parlait, m’avait-on dit, qu’un mauvais italien, j’ai le front d’aller entendre des chevriers qui se sont inventé une langue et ont presque été reconnus comme un peuple, heureusement le Sénat a réagi. Au sud de la Loire, j’ai mis en gerbe les parlers romans qui ont été les premiers à émerger du latin, qui ont donné à l’Europe une liasse de chefs-d’œuvre en un langage rayonnant, qui ont perdu ce capital sur un chemin de bâillon et de révoltes ; se sont quasi retrouvés eux-mêmes et glorieux il y a cent cinquante ans, ont raflé d’un coup de Mistral un Prix Nobel et ont repris à Philippe le Bel le nom d’Occitans qu’il leur avait donné. Trente-deux départements, imaginez ! Si soudain ça disait oc en chœur ? Je pourrais trouver en un extrême Nord presque belge quelques buveurs de bière qui éructent flamand. Et je m’arrêterais interdit devant cette cuvette rhénane et mosellane où l’on parle francique comme un Franc de bon aloi et l’alsacien comme l’entendait Goethe.
J’ai l’impression d’avoir fait le tour de France. Je l’ai fait avec deux enfants, l’un échappé de la Bressola de Perpignan, l’autre de la Calandreta du Clapas. Mais que le lecteur se fie plutôt à Martel qui dit la même chose d’autre façon, avec un sérieux impeccable digne d’un régent du Collège de France, qui n’est certes pas le Collègi d’Occitània. Il apprendra qu’en langue d’oïl on ne dit jamais que nenni et que l’on y applique le droit avec une intelligence de la glose.
La preuve en est que, pour honorer les progrès mondiaux de la justice culturelle, la France a signé la Charte européenne des langues minoritaires et régionales. Elle s’est depuis lors faite le champion de la diversité universelle. Mais la signature ne valait pas : la République française est une et indiversifiable. Quant à l’universalité, la France des Lumières est elle-même comme l’univers d’Einstein : d’éternité sans bornes, mais fermée.
Avis
Aucun commentaire client pour le moment.
 English
English Français
Français Occitan
Occitan