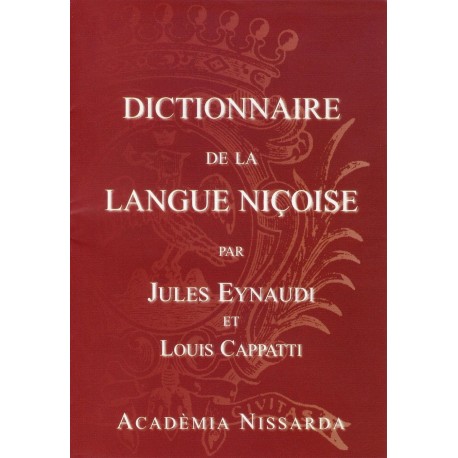Élément(s) ajouté(s) récemment
Aucun produit
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Dictionnaire
- Sélection du moment
- Livres
- Musique
- Videos - DVD
- Objets
- Revues, Journaux
Liens à visiter
Dictionnaire de la Langue Niçoise - Jules Eynaudi et Louis Cappati
L-9782951295549
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
60,00 €
Dictionnaire de la Langue Niçoise - Dictionnaire encyclopédique, l'ouvrage de Jules Eynaudi et Louis Cappati est riche de nombreux articles variés concernant l'histoire des villages, les surnoms, les recettes de cuisines, les proverbes et dictons, chansons,les poids et mesures, les espèces de plantes et d'animaux, ... Publié en 2009 par l'Académia Nissarda.
Fiche de données
| Type | Broché |
| Année | 2009 |
| Langue | Français + Occitan Niçois |
| Pages | 1300 |
| Format | 21 x 30 cm |
| Distributeur | Académia Nissarda |
| ISBN | 2-9512955-4-9 |
| Bonus | Jaquette en quadrichromie avec rabats, ouvrage toilé, papier créator 90 grammes. |
Plus d'infos
Dictionnaire de la Langue Niçoise par Jules Eynaudi et Louis Cappati, 1766 – 1838
Dictionnaire encyclopédique, l'ouvrage de Jules Eynaudi et Louis Cappati est riche de nombreux articles variés concernant l'histoire des villages, les surnoms, les recettes de cuisines, les proverbes et dictons, chansons,les poids et mesures, les espèces de plantes et d'animaux, etc.
Partie niçoise par Jules Eynaudi.
Partie française, géographique et historique par Louis Cappati.
Éditeur Académia Nissarda.
Critique:
Le Dictionnaire de la Langue Niçoise signale au mot prononciation: Le tempérament phonique du nissart diverge de celui du provençal. Le provençal a des finales en o,non accentuées et même muettes, qui font de ce langage un parler oxytonique, sous le rapport des motsoriginairement en a. Le niçois, au contraire, a conservé ses désinences normales, non accentuées, maisnon muettes, ni même simplement affaiblies à un degré quelconque.
En novembre 1931, Eynaudi décide de commencer par fascicules la publication du Dictionnaire de la langue niçoise. Au mot félibre est précisée la portée de l'ouvrage. Le mouvement du félibrige, né en Provence, s'estrépandu dans les régions voisines avec un esprit regrettable d'annexion qui lui a nui. Mais il a contribué puissamment à sauver le passé et la cause du Midi perdue au Moyen Age par ceux dont les descendants s'en sont proclamés les porte-drapeau. La graphie provençale n'est adoptée que par esprit de vulgarisation, sans considération scientifique.
Comme il n'a vécu que souta-castèu, Jùli décide aussitôt de n'écouter que le langage qui monte au dôme ventru de la cathédrale et celui des coteaux qu'observe le candélabre de son clocher. Il recueille toute la richesse d'un dialecte qui a diminutifs et augmentatifs, aguia, aguiassa, aguieta. Il donne la conjugaison des verbes si souvent irréguliers. Il cite la grammaire de Calvino et de Sardou pour expliquer l'usage qu'il fait des lettres. H est mis après C pour indiquer le son tch: chamineia. J devant une consonne vaut dj: lou pous de Jacob, lou Jesu. E bien entendu vaut é. L'u français et provençal, n'existe pas en italien. Il conserve en niçois la valeur française sans être coiffé d'un tréma. L'u italien est remplacé par ou: lou farassoun. Eynaudi écrit: noun, et cependant, comme les Provençaux, ce qui est illogique, il écrit claveleron, qui se prononce claveleroun. Il écrit aussi l'aurange, pour le son l'aourange.
L'ouvrage d'Eynaudi vient après celui de l'abbé Pellegrini: Premier essai d'un dictionnaire niçois,français, italien, Nice, 1894, œuvre d'un vieux prêtre de tendance ultramontaine; après celui de J.-B.Calvino: Nouveau dictionnaire niçois-français, Nice, 1903, plus complet, mais composite; après celui du regretté docteur Louis Camous (de Nice): Lexique niçois, français, provençal, Nice, 1930, œuvred'un médecin qui, ancien maire de Châteauneuf, connaissait à fond la vallée du Paillon. Dans Les Annales du Comté de Nice, Pierre Isnard a entrepris de rassembler les noms dialectaux niçards pour l'étude des sciences naturelles dans le Comté de Nice.Le Dictionnaire groupe les mots selon leur origine: Foga — fougous — fougousamen; — front; aug.frountas; dim. Frountet; frountal, ala; frountiera; frountispici; frountoun. La majorité des mots niçois n'ont pas de pluriel. La fea, li fea; la frema, li frema; la fiera, li fiera, lou fidé, lu fidé; lou fiéu, lu fiéu; l'enfan, lu enfan. Eynaudi souligne les quelques mots qui ont un pluriel, la bugadiera, li bugadieri; la lachiera, li lachieri. Ces mots font exception parce qu'ils sont restés, ensomme, employés comme des épithètes. On dit lou bugadié, lou lachié. Nous lisons des locutions: Bastian countràri, Madame Real es mouarta. Le Dictionnaire les explique.Vous pourrez méditer sur l'application des mots en lisant des textes d'auteurs locaux. Eugène Emanuelvous donnera une impression de terreur avec ce fantôme Pellegrin errant sur ces crêtes désertes etravinées où frappe le tonnerre qui laisse des légendes de peur, après ses coups.
Se l'average si degouola,
Se la gragnola pista tout,
O se la mula fa la fouola
E dei plantun manja lou brout,
S'ai enfan li ven la magagna
E se la frema fa de trin,
Es la terrour de la mountagna,
Es lou Fantaume Pellegrin!
Vous pourrez lire La Bouquetiera de François Guisol, A li Baumèta de Martin-Saytour, l'Ode à Nicede Jùli Eynaudi.
Souta lu mount surgènt tant aut,
Doun l'oulivié au jou s’argènta,
Davant lou flot jouious que mènta
Quoura l'azur es sèmpre caut,
Mouostres asprous e turbulènta,
L'Alpa caiant m’ai siéu ressaut
L'infernal e proumié sursaut
Doun boufa un vènt que si lamènta.
Avis
Aucun commentaire client pour le moment.
 English
English Français
Français Occitan
Occitan