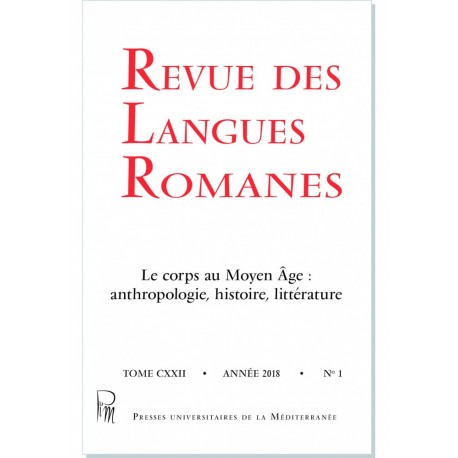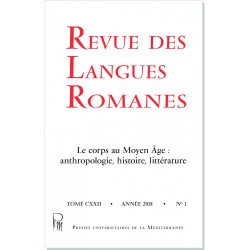Élément(s) ajouté(s) récemment
Aucun produit
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Histoire - Etudes
- Sélection du moment
- Livres
- Musique
- Videos - DVD
- Objets
- Revues, Journaux
Liens à visiter
Revue des Langues Romanes - Tome 122-1 (2018 n°1)
L-9782367812779
Neuf
1 Elément
En stock
27,00 €
Tome 122-1 de la « Revue des langues romanes » (revue de linguistique, de littérature et de philologie romanes): Le corps au Moyen-Âge : anthropologie, histoire, littérature, premier volume de l'année 2018 (Tome CXXII - PULM).
Fiche de données
| Type | Broché |
| Année | 2018 |
| Langue | Français + Occitan |
| Pages | 252 |
| Format | 14 x 22 cm |
| Distributeur | Presses universitaires de la Méditerranée (PULM) |
| Label | Collection « Revue des langues romanes » |
| ISBN | 978-2-36781-277-9 |
| ISSN | 0223-3711 |
Plus d'infos
Revue des langues romanes - Tome 122-1 - Année 2018 n° 1
Le corps au Moyen-Âge : anthropologie, histoire, littérature.
Premier volume annuel 2018 de la revue de linguistique, de littérature et de philologie romanes, éditée par les Presses Universitaires de la Méditerranée (PULM).
La Revue des langues romanes, désormais plus que centenaire, continue à exploiter les riches terrains de la philologie des langues romanes, au sens classique du terme, et du texte littéraire occitan.
Ce premier numéro annuel de 2018 est consacré au corps au Moyen-Âge : anthropologie, histoire, littérature.
Études réunies par Patrick Henriet avec le concours de Jean-René Valette
Éditeur: Presses Universitaires de la Méditerranée (PULM).
Table des matières:
Patrick Henriet: Avant-propos
Fondements anthropologiques de la corporéité médiévale
Daniel Heller-Roazen: Le Corps Tactile
Jérôme Baschet: L’humain (et l’institution) comme paradoxe, Le corporel et le spirituel dans l’Occident médiéval
Gilbert Dagron (†): Le corps dans l’anthropologie chrétienne du Moyen Âge oriental
Dissimuler ou montrer ?
Michel Zink: Corps visible, corps caché dans la poésie des troubadours
Gil Bartholeyns: Le tiers terme: le vêtement et la rationalité politique du corps au Moyen Âge
Varia
Jean-Pierre Chambon: Pour le commentaire du Libre dels Grands jorns de Jean Boudou : quatre notes
Josef Prokop: La prise de conscience de la tradition littéraire des troubadours en France au xvie siècle
Sergio Vatteroni: Le décasyllabe dans quelques contrafacta galégo-portugais de modèles occitans
Critique
Claire Torreilles: Du Bartas (1578), Rosset (1597), Despuech (1633). Trois mises en scène des lieux et des langues. Édition de David Fabié et Philippe Gardy. Classiques Garnier, 2017, 173 p.
Extrait de l'avant-propos:
La société médiévale fut trop profondément marquée par le christianisme et son fonctionnement fut trop lié à celui de l’Église pour que l’on puisse aujourd’hui traiter du corps au Moyen Âge sans rappeler brièvement quelques éléments fondamentaux d’anthropologie chrétienne. C’est à l’époque patristique, dans un contexte souvent polémique, que s’est définie celle-ci. L’élément essentiel en est sans doute la perception de l’Homme comme composé indissociable de deux éléments, l’âme et le corps, qui, même s’ils ne sont pas dotés d’une égale dignité, et même si celui-ci doit être subordonné à celle-là, se complètent sans s’opposer. Dans son De bono mortis, saint Ambroise donne une description saisissante de cette construction qui exclut définitivement tout dualisme explicite : « L’âme du juste se sert du corps comme d’un outil ou d’un instrument : comme un habile artiste, elle fait exécuter à son corps ce qu’elle veut, elle s’en sert pour produire la beauté qu’elle a choisie, elle lui fait exprimer la voix des vertus qu’elle préfère, tantôt les accents de la chasteté, tantôt ceux de la tempérance, le chant de la sobriété, la douceur de l’intégrité, la suavité de la virginité, la gravité du veuvage » . En d’autres termes, contrairement à ce qui a parfois été affirmé dans certaines études sur le contemptus mundi chrétien, le corps n’est pas mauvais mais neutre. Chez les ascètes de l’extrême eux-mêmes, chez les Pères du désert emmenés par saint Antoine, prévaut l’idée que les mortifications n’ont pas pour but d’annihiler le corps (les ermites vivent d’ailleurs plus longtemps que les autres hommes, tel Antoine qui meurt à 105 ans) mais plutôt de le fortifier . Le christianisme a donc permis une valorisation du corps, qui devait ressusciter tel qu’en lui-même : cette conviction était profondément étrangère à la culture classique. On connaît les mots de Celse rapportés par Origène, selon lesquels les chrétiens se contredisent en croyant à la résurrection du corps tout en exposant celui-ci à des supplices. La réponse d’Origène, parfaitement claire, anticipe le passage du De bono mortis d’Ambroise : « […] le corps qui souffre pour la religion et choisit les tribulations pour la vertu n’est aucunement méprisable ; ce qui est entièrement méprisable, c’est le corps qui s’est consumé dans les plaisirs coupables » . En d’autres termes, le corps est un instrument dont le chrétien fait ce qu’il veut. Ce refus de la dichotomie, classique dans le monde antique, entre corps et âme, trouve sa source première dans l’incarnation du Christ : Dieu a pris chair pour le rachat du genre humain, ce qui induit évidemment un rapport consubstantiel entre la condition charnelle et l’espoir d’un salut corps et âme : « si la chair ne devait pas être sauvée, le Verbe de Dieu ne se serait pas fait chair », écrit Irénée dans son traité sur les hérésies . La chair n’est donc pas un pis-aller mais une nécessité, elle est le point cardinal autour duquel s’articule la mécanique sotériologique : Caro salutis est cardo, « la chair est le gond du salut », écrit Tertullien dans son De resurrectione mortuorum .
[...]
Avis
Aucun commentaire client pour le moment.
 English
English Français
Français Occitan
Occitan