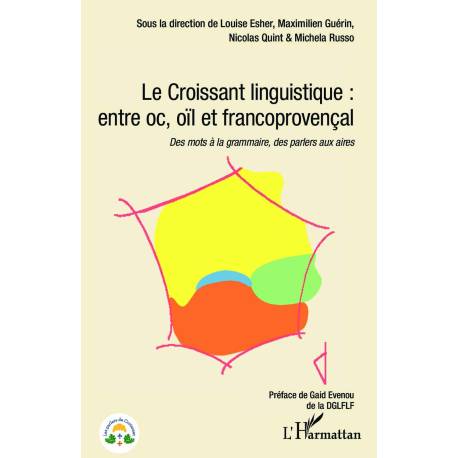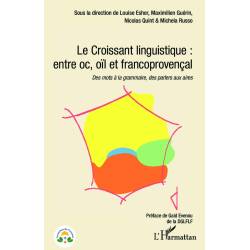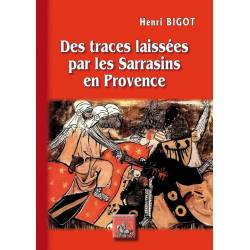Élément(s) ajouté(s) récemment
Aucun produit
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Linguistique - Toponymie
- Sélection du moment
- Livres
- Musique
- Videos - DVD
- Objets
- Revues, Journaux
Liens à visiter
Le Croissant linguistique: entre oc, oïl et francoprovençal - Des mots à la grammaire, des parlers aux aires
L-9782343230504
Neuf
1 Elément
En stock
42,00 €
Le Croissant linguistique: entre oc, oïl et francoprovençal - Des mots à la grammaire, des parlers aux aires. Sous la direction de Louise Esher, Maximilien Guérin, Nicolas Quint & Michela Russo. Les parlers de cette zone remettent en question les frontières intangibles et les catégories établies. Collection Les Parlers du Croissant (volume 5), L’Harmattan.
Fiche de données
| Type | Broché |
| Année | 2021 |
| Langue | Français |
| Pages | 376 |
| Format | 15,5 x 24 cm |
| Distributeur | Éditions L’Harmattan |
| Label | Collection Les Parlers du Croissant |
| ISBN | 978-2-343-23050-4 |
Plus d'infos
Le Croissant linguistique: entre oc, oïl et francoprovençal - Des mots à la grammaire, des parlers aux aires
Sous la direction de Louise Esher, Maximilien Guérin, Nicolas Quint & Michela Russo.
Le Croissant correspond à la zone mixte où se rejoignent les trois grandes aires gallo-romanes : oc, oïl et francoprovençal. Il s’étend de la Montagne bourbonnaise (Allier) au centre de la Charente. Les parlers qu’on pratique dans cette zone, présentant simultanément des traits caractéristiques de l’occitan, des langues d’oïl et parfois du francoprovençal, remettent en question les frontières intangibles et les catégories établies. Pas vraiment (ou pas suffisamment ?) d’oc, pas vraiment d’oïl, pas vraiment francoprovençaux non plus, les parlers du Croissant sont longtemps restés en marge des études sur le langage. Ces parlers, désormais en voie d’extinction, méritent pourtant d’être davantage (re)connus, tant sur le plan scientifique que patrimonial.
Le projet collectif « Les Parlers du Croissant », associant chercheurs et locuteurs, aspire à illustrer et étudier ces variétés dialectales originales, en collectant des données auprès des personnes qui les pratiquent encore ainsi qu’en faisant la synthèse des sources disponibles. Le présent ouvrage est le fruit des efforts que l’équipe du projet consacre aux parlers du Croissant depuis maintenant plus de cinq ans, dans une perspective ouverte et pluridisciplinaire.
Préface de Gaid Evenou de la DGLFLF. Illustration de couverture de Guylaine Brun-Trigaud, 2020.
Collection Les Parlers du Croissant (volume 5), L’Harmattan.
Les auteurs:
Avec la participation de: Gilles Adda (CNRS-LIMSI), Laurène Barbier (Inalco), Christian Bonnet (Université Clermont-Auvergne & CNRS-IHRIM), Philippe Boula de Mareüil (CNRS-LIMSI), Guylaine Brun-Trigaud (CNRS-BCL), Benoît Dazéas (Lo Congrès), Amélie Deparis (Inalco & CNRS-LLACAN), Aurélien Diéterlé (Inalco), Jean-Christophe Dourdet (Université de Poitiers), Jean-Michel Effantin (Association du Patrimoine de l’Herbasse), Louise Esher (CNRS), Gaid Evenou (DGLFLF), Maximilien Guérin (CNRS-LLACAN), Marc-Olivier Hinzelin (Université de Hambourg), Lori Lamel (CNRS-LIMSI), Sylvain Loiseau (Université Sorbonne Paris Nord & CNRS-Lacito), Flore Picard (Sorbonne Université), Nicolas Quint (CNRS-LLACAN), Michela Russo (Université de Lyon & CNRS-SFL), Sylviane R. Schwer (Université Sorbonne Paris Nord & CNRS-LIPN), Aure Séguier (Lo Congrès).
Article critique:
Le Croissant linguistique : entre oc, oïl et francoprovençal est le premier ouvrage général dans le domaine des études croissantines. Ce travail collectif, dirigé par Louise Esher, Maximilien Guérin, Nicolas Quint et Michela Russo, a été réalisé à l’issue de deux projets ANR dont l’objectif était d’appréhender les parlers de l’aire du Croissant, leur complexité et diversité à l’intérieur de cet espace, ainsi que leur spécificité par rapport aux variétés limitrophes (et en contact) de type oïl, oc et francoprovençal.
L’ouvrage de 376 pages réunit des contributions d’auteurs spécialistes d’approches disciplinaires diverses de l’étude du langage et montre un fort ancrage dans le contexte historique, social et linguistique croissantin. Il répond à une volonté de combiner la réflexion historique et sociolinguistique sur le développement de la linguistique de contact dans l’espace croissantin et l’analyse de l’état de la recherche dans ses principaux champs d’investigation. Les contributions s’appuient en effet sur des recherches menées selon des perspectives différentes (synchronique et diachronique, comparative et interdisciplinaire) tenant compte du contact linguistique.
Le volume, qui s’ouvre avec une préface de Gaid Evenou, de la DGLFLF soulignant l’importance de l’étude et de la sauvegarde des langues locales, s’articule autour d’une introduction réalisée par les éditeurs scientifiques (Esher, Guérin, Quint et Russo, p. 15-28) et de dix-sept textes répartis en cinq sections relativement indépendantes les unes des autres, portant sur les structures des variétés dialectales du Croissant et sur les facteurs historiques et sociaux liés aux conditions d’utilisation de ces variétés : Enjeux descriptifs (constituée de deux contributions : p. 29-62) ; Études aréales (trois contributions : p. 63-141) ; Dialectométrie et outils TAL (quatre textes : p. 143-201) ; Flexion verbale (également, quatre chapitres : p. 203-296) ; Lexique et formation des mots (deux contributions : p. 297-334) ; Littérature et corpus (formée, également, de deux textes : p. 335-373). Si ces contributions touchent à des sujets d’ordre divers, néanmoins les thématiques principales se croisent et traversent les sections du recueil : quels que soient les aspects abordés, les chercheurs mettent au cœur de leurs interrogations la question de la variation et du contact linguistique dans le temps et dans l’espace, à travers l’analyse des propriétés structurelles des variétés locales et la réflexion autour de sujets tels que les pratiques langagières au sein des communautés observées, les représentations sur la (les) langue(s) locale(s), les enjeux identitaires de ces pratiques et représentations pour les locuteurs.
Comme l’expliquent Esher, Guérin, Quint et Russo (p. 15), le Croissant linguistique présente les caractéristiques idéales d’un terrain privilégié pour l’étude de la variation selon les perspectives diatopique et sociale, en vertu de sa position frontalière et de contact des trois principales langues du domaine gallo-roman. Pourtant, malgré un intérêt datant déjà du 19e siècle, illustré notamment par les travaux de Rousselot ou encore de Tourtoulon et Bringuier, cet espace (socio) linguistique est resté pendant longtemps dans l’ombre, pénalisé justement par son caractère « mixte » et par la présence encombrante de variétés plus reconnaissable et « visibles », en quelque sorte plus « nobles », « réputées », telles que l’occitan, l’oïl et (sans doute en moindre mesure) le francoprovençal.
Il est possible de mettre en évidence quelques éléments de convergence entre les différentes sections. En particulier, dans les contributions composant les trois premières sections l’observation se focalise surtout sur des terrains assez précis avec des objectifs principalement descriptifs des parlers locaux (à des échelles variables : Deparis, p. 31-45 et Barbier, p. 47-62 à l’échelle communale ; Russo, p. 65-106, Dourdet, p. 107-128 et Loiseau, p. 129-141, selon une approche aréale plus vaste à l’intérieur de l’espace croissantin ; Brun-Trigaud & Picard, p. 145-157, Boula de Mareüil, Adda & Lamel, p. 159-172 et encore Brun-Trigaud, p. 173-181, selon une approche dialectométrique appliquée aux parlers du Croissant sur la base de sources différentes), tandis que la contribution de Dazéas & Séguier (p. 183-201) porte plutôt sur le développement des outils TAL pour les parlers du Croissant à partir de ressources déjà existantes pour la langue occitane. Dans la deuxième partie du volume, l’accent est posé davantage sur les niveaux verbal (Hinzelin, p. 205-227 ; Quint, p. 229-259 ; Esher, p. 261-276, Diéterlé, p. 277- 296), lexical (Guérin, p. 299-312, et Schwer, p. 313-334) et textuel (Bonnet, p. 337-352, et Effantin, p. 353-373). L’approche comparatiste caractérise, également, l’ensemble de ces contributions, tant à l’intérieur du groupe croissantin (notamment, Hinzelin ; Esher ; Schwer) que vers l’extérieur (en particulier, Quint), favorisant l’ouverture vers de possibles généralisations, comme dans l’analyse de corpus littéraires en contexte de minorisation ou dans la réflexion sur les conditions historiques et sociales d’évolution des systèmes de numération.
Le Croissant se signale comme un riche laboratoire pour l’étude des langues dites « régionales » de France, pour l’étude du contact sur le plan structurel et sur le plan des perceptions, des attitudes et de la conscience linguistique de ses locuteurs. On pourra alors se demander, en faisant écho au titre de l’introduction, si le Croissant se définit comme une aire de frontière du fait de son caractère mixte et ses confins géolinguistiques nuancés, ou si celui-ci représente un véritable centre de gravité identifié/identifiable dans l’espace gallo-roman, dont il constituerait donc le quatrième groupe aux côtés de l’oïl, de l’oc et du francoprovençal. On notera, par ailleurs, que d’importantes analogies se dessinent entre ce dernier et le croissantin. En effet, comme le souligne en particulier Russo dans sa contribution au volume, le francoprovençal contribue avec l’occitan et l’oïl à la formation des variétés du croissantin dans ses limites à l’est (Forez) et au nord occitan (Auvergne). Il est en quelque sorte curieux de remarquer que le même questionnement évoqué à propos des parlers du Croissant (« ensemble de variétés de transition ou groupe linguistique bien défini ? ») et résolu par les auteurs de cet ouvrage par la reconnaissance d’un diasystème autonome, a marqué – et, à certains égards, marque encore de nos jours – la discussion au sujet de son voisin francoprovençal dès sa « découverte » effectuée par le dialectologue italien G. I. Ascoli au xixe siècle : celui-ci a rencontré d’importantes difficultés dans l’obtention d’une reconnaissance scientifique (et politique) au sein du domaine gallo-roman précisément à cause de sa condition intermédiaire géographiquement et structurellement entre les deux groupes linguistiques majeurs (oïl/français et oc), mise en évidence et synthétisée par son même glottonyme.
En conclusion, malgré le risque d’une certaine dispersion thématique (et en quelque sorte inévitable compte tenu de la nouveauté du terrain observé et du cadre de recherche dans lequel s’insère cette publication), ce travail éditorial ouvre une nouvelle et passionnante page de l’étude des langues romanes, et se propose à l’attention des lecteurs pour les nombreuses clés de lecture qu’il offre. Les thèmes abordés, tels que la question des sources et de l’interdisciplinarité, la valeur heuristique de l’aire linguistique, l’interdépendance de réflexion théorique et connaissance empirique dans l’étude de la variation, ou encore la valeur identitaire attribuée à la langue locale dans un cadre diglossique « traditionnel », permettent d’intégrer les études croissantines dans un contexte (socio) linguistique et théorique plus large. La participation de spécialistes reconnus des thèmes scientifiques traités ainsi que la cohérence générale établie entre les contributions du volume rendent Le Croissant linguistique : entre oc, oïl et francoprovençal une référence précieuse dans le domaine de la linguistique gallo-romane et des questions du contact et de la diversité linguistique en France.
Article de Giovanni Depau (Université Grenoble Alpes) publié dans Langage et société 2022/3 (n°177).
Avis
Aucun commentaire client pour le moment.
 English
English Français
Français Occitan
Occitan