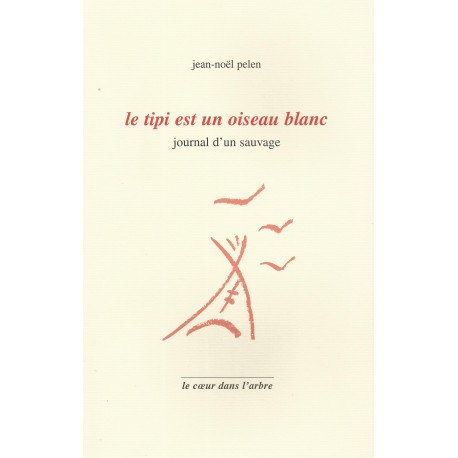Élément(s) ajouté(s) récemment
Aucun produit
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Littérature en Français
- Sélection du moment
- Livres
- Musique
- Videos - DVD
- Objets
- Revues, Journaux
Liens à visiter
Le tipi est un oiseau blanc, journal d'un sauvage - Jean-Noël Pelen
L-9782952962804
Neuf
2 Eléments
En stock
15,00 €
Le tipi est un oiseau blanc, journal d'un sauvage - Jean-Noël Pelen. Essai d’auto-ethnographie: un anthropologue qui se confond au fil du temps avec le sauvage avec qui il ne mesure plus la distance qui le sépare. A la recherche du temps, des mythes, de l'intime, des ancêtres et de la vie. Le Coeur dans l'arbre.
Fiche de données
| Type | Broché |
| Année | 2007 |
| Langue | Français |
| Pages | 126 |
| Format | 15 x 23.5 cm |
| Distributeur | Le Coeur dans l'arbre |
| Label | Aureille |
| ISBN | 978-2-95296-280-4 |
Plus d'infos
Le tipi est un oiseau blanc, journal d'un sauvage - Jean-Noël Pelen
Essai d’auto-ethnographie.
"Le temps est de toute beauté. Le vent est haut, ample, calme. Auprès du sol à peine la brise, qui de temps en temps s'enflamme, faisant chanter sa scie, trembloter les cordages, frissonner la toile, danser les rubans, jouer les ombres. Sur le ruisseau, un oiseau lance des trilles. Je suis assis en tailleur, pieds nus, face à la porte et au soleil. Le cahier est posé sur l'écritoire. J'entrelace les mots. Mon travail d'écriture est pareil à celui du tisserand; Dans bien des mythologies, la parole est liée au tissage. Celui qui dit les mythes tisse la trame du sens, ordonne le monde comme l'est la texture d'une toile. Il fait des objets épars, désordonnés, un assemblage solidaire. En relisant mon cahier je me dis qu'il est cela. Une mythologie concrète du tipi."
Parti pour être ethnographe, l'auteur s'est confondu avec le sauvage, auquel il ne mesure plus la distance. Ainsi marche-t-il dans ses propres pas, interrogeant les profondeurs de l'écriture, du mythe, de l'intime, les formes de l'archaïque, le recouvrement de la durée et de l'instant.
Éditions Le Coeur dans l'arbre.
L'auteur:
Chargé de recherches au CNRS, Jean-Noël Pelen est spécialisé dans les questions de littérature et traditions orales, ainsi que d'identité culturelle. Il a publié plusieurs monographies sur les Cévennes et la Provence et de nombreux articles scientifiques. Il était directeur du Centre de recherches sur les ethnotextes, l'histoire orale et les parlers régionaux, à l'Université de Provence en 2010.
J’ai conduit des recherches plus solitaires sur la mystique de la nature que j’avais croisée dans le travail précédent et, en tant qu’ethnographe, j’ai choisi de vivre un peu "sauvagement", on peut dire "dans les bois" pour aller vite, cela pour comprendre, en l’expérimentant, certaines dimensions de cette mystique. On dit que l’ethnographie est observation mais je pense qu’elle doit être aussi parfois expérimentation. Ce serait à débattre. Pour rendre compte de cela, j’ai écrit un court journal de terrain que j’ai auto-édité.
Extraits:
J'écris sous le tipi. J'écris sur ma demeure et sur mon âme. Aussi ne dois-je pas me presser pour écrire ce livre. Car il est le livre de l'âme. Toutes les choses qui sont là parlent de l'âme. C'est cela le tipi. Il n'y a pas de place pour le superflu. Tout ce qui y est doit tenir du vital. Cette redéfinition du vital, en ôtant la profusion du superflu, ramène à l'esprit. Car celui-ci est reconduit à des choses simples.
[...]
J’ai eu cette grande chance, d’une cohérence improbable dans mon parcours social et mon être-moi-même, de vivre sous un tipi, durant quelques saisons. j’y ai croisé le vent continu, faisant battre la toile et chanter les perches. les pluies du sud impétueuses tambourinant leur mélopée galopante. le froid surgissant de nuit, à feu éteint, à ne plus quitter son bonnet et ne plus oser respirer, de peur que les poumons ne gèlent. la chaleur languissante sous la canicule, dérobant à l’être toute substance autre que la certitude et la douceur de perdurer, malgré tout, dans la torpeur.
J’y ai observé le jeu des ombres et de la lumière, admirant la projection dansante des feuillages sur la toile ensoleillée, étant saisi de l’illumination par le feu, à nuit tombée, d’êtres présentement archaïques, qui venaient me visiter pour quelques heures non comptées. j’en suis sorti souvent pour goûter, par lune noire, le ciel déchiré d’étoiles, et je me suis encore nourri, avant qu’elle ne s’éteigne, de la disparition du ciel de jour, la lueur du soleil traversant le tipi de raies horizontales, lovées au ras du sol mais néanmoins triomphantes de leur beauté éphémère. je me suis abreuvé du découpage des perches dressé à pleine lune, autel sombre prostré devant une déité de lumière.
J’ai eu cette chance d’habiter, pour quelques jours ou quelques nuits, d’autres tipis, hôte d’êtres conscients de leur destinée. j’ai vécu seul ou partagé des tempêtes réjouissantes, des grêlons à foison parsemant la forêt d’une épaisse couche scintillante, des cascades d’orages à jeter dans le feu, inévitablement trempé, des brassées de bois. des vents ébouriffés, à observer les perches, craignant qu’une bourrasque n’arrache les pieux ou ne fasse exploser la toile d’un soudain gonflement. toujours profondément heureux, comme le petit Cazaux quêtant fiévreusement l’Homme Vert, « de voir des choses qui n’arrivent pas chaque jour ».
Je me suis attaché à y vivre simplement, dans cette liberté retrouvée, allégé d’impératifs illusoires. le feu a cuit ma nourriture, éclairé mon gîte, réchauffé mon antre, séché mes habits, illuminé mon âme. je l’ai reçu et offert en partage à ceux qui passaient, comme une source vive et sacrée, qui régénère l’être dans sa profondeur. j’y ai appris à faire ma couche, observant qu’il ne suffisait pas de se couvrir, mais surtout de s’isoler du sol, et que pour cela les genêts fibreux constituaient la plus onctueuse des litières.
L’instant m’a dépouillé de tout récit. nul autre que moi-même, nul passé ni futur pour porter mes fardeaux. contre l’instant l’âme se purifie. nulle horloge pour m’imposer ses rouages. nulle lumière autre que le feu, le soleil, les étoiles, ou une vague bougie, certes constituée de pétrole. mais l’ouverture des pupilles. nul autre récit que le temps qu’il fait, le bois mouillé, le thé brûlant, la Présence de l’Ami.
Le tipi, me dit Sophie, est une forêt. nous sommes assis dans la clairière des perches et le faîte de ces arbres environnants est noué, au sommet du tipi, là où les perches s’entrecroisent, d’un unique accord. pour moi le tipi est une matrice, dit Mononoké. les oreilles grandes ouvertes sont comme les lèvres généreuses d’une déesse originaire, offrant au regard sa vulve sans honte, au sein de laquelle l’on s’endort, en toute quiétude, toujours naissant. pour moi, dis-je, le tipi est un oiseau blanc, dressé sur la prairie dans un entre-deux, dans l’instant sans fin se posant et ébrouant son vol.
Quelques pierres entourent le feu, qui jette sur le pourtour de la toile, comme d’antiques dieux, leurs ombres profondes. que faisais-je là. j’essayais de vivre. j’interrogeai une étrange question. les fourmis envahissaient ma couche. les mulots mangeaient mon riz. les blancs escargots collés aux perches. les lézards sur la toile s’engorgeant de soleil. l’instant s’était ouvert d’une immensité. depuis quand cette lune. depuis quand ce soleil. depuis quand ces ombres et ces lumières. ce ruisseau où je lave mon linge, nettoie ma vaisselle, ravive mes pieds. depuis quand la poussière de ce chemin sur lequel je marche à pieds nus, la bourre scintillante des peupliers, la farandole angulaire des libellules au dessus du trou d’eau miroitant.
Depuis presque toujours, me disais-je alors dans mon innocence. je me glissais dans l’ouverture du temps. depuis toujours. le soir, à la veillée, me venait ce saisissement de l’antiquité du feu. combien d’autres hommes, autrefois et encore, en combien d’autres lieux, l’avaient-ils pareillement contemplé, s’étaient-ils semblablement réjouis, réchauffés de sa flamme. combien de chants a-t-il accompagnés, de toute humanité.
Aussi, devant ce partage d’une même lumière – que dire d’autre –, me venait l’étrange et juste sensation d’une fraternité profonde d’expérience. je partageais plus avec cette humanité du feu qu’avec celle – socialement enfermée – qui m’entourait. mon champ de référence, de fraternisation, dans l’espace et l’histoire, s’agrandissait incroyablement à ma conscience étonnée. toute la surface presque de la Terre. je me complaisais alors à retrouver les façons d’usages ancestraux, partagés, vérifiés. comment choisir justement mon bois. comment constituer, lier et porter justement mon fagot. comment faire et conduire justement mon feu. chaque acte devenait rite en ce qu’il retrouvait et répétait, par la force même de sa nécessité simple, un geste quasi millénaire, sans territoire, auquel conduisait peu à peu l’ajustement de son dessin à son dessein, en une hasardeuse mais signifiante harmonie d’une même sonorité. en cet acte l’humanité se réaccomplissait d’un même mouvement, mythifié d’être opéré dans un instant ouvert, traversé, échappé aux contraintes de temps et d’espace.
A moment convenu pour chaque chose, mon mobilier se simplifia. mes objets se raréfièrent et s’épurèrent, retrouvant l’âme de leur fonctionnalité. à l’usage du vent, du soleil, du feu, mon corps se délia. mes vêtements, ma peau furent imprégnés de l’odeur forte de bois brûlé. je m’émaciai. mes habits s’usèrent, s’effilochèrent, mais je leur portais fidélité. je les usais avec respect et jusqu’à n’en plus, pour les remercier de leurs jours de service, jusqu’à ce qu’ils se défassent d’eux-mêmes, ayant accompli leur mission.
Je rédigeai un journal, comme l’on cherche à s’approfondir, en observant son image inversée, dans un miroir. les mots y éclairaient les choses et l’expérience nourrissait les mots. nul écart, entre le soleil et la feuille, nulle distance entre l’âme et l’encre, la pensée et sa calligraphie. comme sur la toile du tipi, dansaient sur mon cahier la silhouette des branches projetée par l’astre, la lueur mobile de la bougie, le caprice du feu, et les mots se tissaient de ces jeux de lumière et de pénombre. l’objet de l’écriture se manifestait, lumineux et chatoyant, sur le papier. je n’écrivais que l’instant. mais au matin, il fallait que mes pas s’inscrivent dans les mots de la nuit, pour que l’être soit identique à lui-même, ipse, dans ses pas et son dire. nul mensonge possible. nulle illusion, ni même fantaisie. le récit proférait le réel et – ainsi qu’il en est de toute antique profération – le réel en était la preuve. je dénommais ce journal, inconsidérément, journal d’un sauvage.
Je me lavais à l’eau claire et sans savon, pour m’alléger de mes fatigues, clarifier mes sens, me dépouiller de mes souillures, offrir à mon être une fraîcheur, un recommencement.
J’habitais une forme, dont la puissance agissante me reconfigurait. cela n’eût pas été la même aventure que d’habiter une cabane, une grotte, une yourte. à chaque forme et matériau son onde, sa capacité. je ne vivais, dans le tipi, qu’assis ou allongé, faute de pouvoir, en raison de sa taille réduite, y tenir debout. ramené au sol, collé à la Terre. parfois, les nuits d’orage, je ressentais sur ma poitrine le tremblement du sol sous la roulée du tonnerre. cela me réjouissait. je vivais au bord du feu, dormais contre lui, devant les flammes et la chaleur ascendantes, au centre d’un cercle. la ramure des perches se projetait au ciel pour se réunir en haut du cône en un unique point, avant que de se redisperser, par l’élancement extérieur des perches, vers la grande voûte du ciel.
Etrange voyage cela fut-il. le tipi me reliait à un monde élargi. j’y revisitai, sans le savoir encore, quelques mots après lesquels j’avais couru comme auprès d’une source, mais desquels je m’étais détourné pourtant avec honte, comme s’ils étaient ternis d’une tache.
« sauvage ». qui n’est pas apprivoisé. qui n’est pas civilisé, qui vit en dehors de la civilisation. dont le mode de vie est archaïque. du latin silvaticus, relatif à la forêt.
« indigène ». qui est natif du lieu. originaire du pays. qui appartient à un groupe ethnique d’un pays d’outre-mer avant sa colonisation.
« primitif ». qui est à son origine, près de son origine. se dit des groupes humains qui ignorent les formes sociales et les techniques des sociétés dites évoluées. latin primitivus, qui naît le premier.
N’était-ce pas cela que je recherchais. je m’attachais à vivre en dehors de la civilisation, quoique j’en sois, mais à me défaire de ses hantises. je m’attachais à être du lieu. en harmonie avec. je m’élançais vers la quête illusoire de gestes originaires, de pensées sans passé. mais n’était-ce pas cela aussi auprès de quoi avait couru toute l’ethnographie, depuis l’origine, ab origine : les sauvages, les primitifs, les indigènes.
Je fis d’étranges rencontres, avec des faits inattendus, des êtres jusque-là séparés et distants. je dus abandonner ma raison pour accepter cette existence. une conjonction de hasards dans les manifestations des oiseaux m’interrogea sur une évidence perdue, un possible assèchement des perceptions.
« Autochtone ». du grec autokhthôn, de autos, soi-même, et khthôn, Terre. autochtone : soi-même-Terre. cette reliaison qu’alors pourtant je ne pensais pas me travaillait par devers moi. sauvage, primitif. c’est dans la virginité réappropriée de ces vocables que se conduisait mon chemin. je recherchais un état d’origine, un vécu et des gestes premiers, sans distance, vrais depuis l’origine, ab origine, aborigènes.
Je rencontrais sous les tipis quelques femmes qui ne remettaient leur sang qu’à la Terre, actant ainsi de ne pas se délier. elles se trouvaient de la sorte en concordance à l’origine, depuis l’origine, ab origine. femmes aborigènes. elles n’avaient pas besoin de le dire : elles le faisaient.
J’entrai sous le tipi et le tipi entra en moi. le chemin que j’y fis fut celui que je viens de décrire : je réalisai, au travers de lui, la plénitude de mon être au monde, par une conscience retrouvée, par la cohérence reconstruite des actes les plus simples. j’habitais le monde en toute ouverture.
Je ne suis pas primitif, au sens second – historique – où on l’entend communément. je ne suis pas sauvage ni aborigène. mais que faut-il pour l’être. avoir été assigné comme tel par une civilisation triomphante, et que l’on sait aveuglément dévastatrice. pourtant, désormais, des hommes, des peuples se désignent comme premiers, autochtones, aborigènes, réaffirmant de ces qualificatifs le sens historique mais aussi originel, et leurs revendications sont, sinon honorées, du moins reconnues par les instances internationales. à y regarder de près, ces revendications ne sont pas celles de la possession de territoires, mais bien plutôt, à partir du sens originel, de la responsabilité de ces territoires. ces peuples réclament – non pas pour eux-mêmes mais au nom de tous, au nom de ce qu’ils désignent comme Terre-Mère – la légitimité d’un mode d’habiter dans lequel l’homme se trouve non pas en domination sur ce qui Est mais en juste harmonie avec tout ce qui Est. aussi réclament-ils, pour leurs rites, l’accès aux plumes des oiseaux – « les vraies représentations des dieux sont les plumes rouges, qui sont les symboles véritables de la divinité » –, à la peau de certains animaux, aux plantes, aux herbes, afin d’en user en tout respect pour se relier, par ces rituels, ces médecines, au Tout. car le monde ne peut être fractionné. fractionner le monde, c’est s’autoriser à le détruire. sans la plume de l’oiseau, l’harmonie insécable du monde disparaît.
Aussi me dis-je qu’être primitif, aborigène, autochtone, ne relève pas inconditionnellement d’un héritage ou d’une ascendance singuliers, mais également et surtout d’un point de vue, voire une intention. cette intention ouvre un chemin d’initiation à l’être au monde, qui consiste à conscientiser, acter – sans se départir de son temps ni de son lieu – une juste place de présence et de coopération à l’harmonie du monde en ce qu’il est ab origine, depuis l’origine, fraternisant avec son infractionnable Totalité.
Article critique:
Comment pouvoir imaginer la profondeur d'une existence, le retour dans des conditions de survie à quelque chose de l'ordre de la préhistoire de chacun et un brin de début de l'histoire de l'humanité. le feu, le mythe, l'écriture. Trouver son axe, obligatoire, sa place dans un monde que l'on ne reconnait plus, hors temps, hors cadre, pour que l'existant retrouve son souffle. Cette expérience d'une auto-ethnographie sous forme de journal, va au delà de la recherche de l'auteur puisqu'elle touche ce qui appartient à chacun d'entre nous, le combat pour rester soi-même.
Critique de Flamenca, publiée le 7 mars 2010 sur Babelio.com
Avis
Aucun commentaire client pour le moment.
 English
English Français
Français Occitan
Occitan