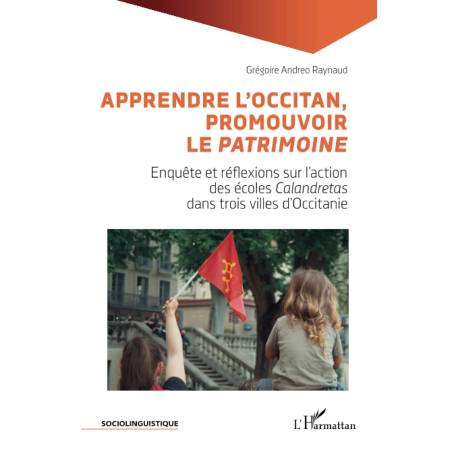Élément(s) ajouté(s) récemment
Aucun produit
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Linguistique - Toponymie
- Sélection du moment
- Livres
- Musique
- Videos - DVD
- Objets
- Revues, Journaux
Liens à visiter
Apprendre l’occitan, Promouvoir le patrimoine - Enquête et réflexions sur l'action des écoles Calandretas - G. Andreo Raynaud
L-9782140308581
Neuf
2 Eléments
En stock
31,50 €
Apprendre l’occitan, Promouvoir le patrimoine - Enquête et réflexions sur l'action des écoles Calandretas dans trois villes d'Occitanie - Gregoire Andreo Raynaud. À partir d'une enquête ethnographique, l'auteur analyse la portée de cette politique linguistique par en bas sur la situation sociale de la langue-culture occitane dans ces territoires, plus de 40 ans après leur création. L’Harmattan.
Fiche de données
| Type | Broché |
| Année | 2023 |
| Langue | Français |
| Pages | 306 |
| Format | 15,5 x 24 cm |
| Distributeur | Éditions L’Harmattan |
| Label | Collection Sociolinguistique |
| ISBN | 978-2-14-030858-1 |
Plus d'infos
Apprendre l’occitan, Promouvoir le patrimoine - Enquête et réflexions sur l'action des écoles Calandretas dans trois villes d'Occitanie - Gregoire Andreo Raynaud
Les Calandretas sont des écoles associatives créées à Pau en 1979 et qui enseignent la langue occitane selon des modalités immersives et des méthodes empruntées à C. Freinet et à la Pédagogie Institutionnelle. À partir d'une enquête ethnographique menée dans trois villes de la région Occitanie, l'auteur analyse la portée de cette politique linguistique par en bas sur la situation sociale de la langue-culture occitane dans ces territoires, plus de 40 ans après leur création.
Ce terrain de trois ans a conduit l'auteur à rencontrer plus d'une centaine d'acteurs : élèves et anciens élèves, parents, enseignants, acteurs associatifs et politiques liés à la question occitane. À travers différentes données issues d'approches diverses, l'ouvrage décrit comment ces écoles/associations influencent positivement les pratiques et les représentations de la langue-culture occitane mais il met aussi en lumière les facteurs limitant la réussite de ces objectifs. L'auteur invite également à une réflexion plus large sur l'utilisation du terme patrimoine pour catégoriser la langue-culture occitane.
Cet ouvrage analyse l’action des Calandretas en tant que politiques linguistiques « par en bas » (venues du terrain et des populations, au travers en particulier d’initiatives associatives militantes) par opposition aux réponses « par le haut » venant de diverses institutions dotées d’un pouvoir matériel et symbolique supérieur (Région, État…). L’approche englobante et critique des politiques linguistiques dans laquelle cette thèse s’inscrit vise à analyser l’ensemble des enjeux sociaux soulevés ce type d’action glottopolitique dans le contexte de la revitalisation des « langues en danger » ainsi que ses effets concrets sur le terrain. La première partie est consacrée à poser le cadre méthodologique et à présenter le terrain de l’enquête. Dans la deuxième partie de cette thèse, nous analysons la patrimonialisation en domaine occitan à la fois comme un processus anthropologique participant à la transmission d’une pratique culturelle, comme une construction sociale et enfin comme un discours sur la langue historiquement situé et ces relations avec les concepts de « revitalisation » et de « normalisation » et nous mettons en lien avec les acteurs des politiques linguistiques dont font partie les Calandretas. La troisième partie de ce travail est consacrée à l’appropriation de l’action des Calandretas par les acteurs des politiques linguistiques dans trois villes moyennes d’Occitanie dans le contexte patrimonial précédemment décrit. A travers l’analyse d’un matériel constitué de discours institutionnels, d’entretiens menés avec les acteurs ou encore de discours médiatiques, nous montrons comment les facteurs environnementaux et sociaux influencent localement le déploiement d’une politique linguistique « par en bas ». La quatrième partie s’intéresse à l’appropriation du projet éducatif, linguistique et culturel de Calandreta par les acteurs directement impliqués à savoir les parents, les élèves et les enseignants. A partir de différents types de données issus d’approches qualitatives (entretien, observation participante) et quantitatives (questionnaire) nous montrons comment le passage par une Calandreta influence concrètement les pratiques et les représentations langagières dans le sens d’une plus grande pratique de la langue occitane et d’une meilleure conscience linguistique, mais nous mettons également en lumière les facteurs limitant la réussite de ces objectifs. C’est en effet tout l’enjeu de cette thèse que d’essayer de comprendre d’où provient l’écart entre les objectifs d’une politique linguistique donnée et ses résultats concrets sur le terrain en termes de représentations et de pratiques. C’est dans cet interstice que se mesurent les enjeux sociaux, politiques et économiques qui sont au cœur de l’étude des politiques linguistiques.
Collection Sociolinguistique, L’Harmattan.
L'auteur:
Grégoire Andreo Raynaud est Docteur en sciences du langage. Après avoir soutenu sa thèse d l'université Paul-Valéry Montpellier 3 au sein du laboratoire Dipralang EA739 en 2021, il est aujourd'hui enseignant-chercheur d l'université d'Aix-Marseille, associé au laboratoire Parole & Langage. Cet ouvrage est le résultat des recherches menées dans le cadre d'un contrat doctoral cofinancé parla région Occitanie et l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. La publication a reçu le soutien du Laboratoire DIPRALANG et du Centre International de Recherche et de Documentation Occitane.
Compte rendu du livre:
L’ouvrage est issu d’une thèse de doctorat soutenue en novembre 2021 et financée par la région Occitanie, dont l’objectif était d’« évaluer l’impact des Calandretas sur la valorisation et la promotion du patrimoine régional occitan ».
Le projet rencontrait à la fois l’intérêt de la Région dans le cadre de sa politique patrimoniale et celui des sociolinguistes, en particulier pour les recherches sur le rôle d’une politique linguistique « par en bas ». Les Calandretas, ces « écoles associatives et immersives en occitan » nées dans la mouvance militante occitaniste du début des années 1980 se veulent actrices d’une politique linguistique occitane incitative visant à donner une « conscience linguistique » aux élèves et à exercer une action culturelle dans leur environnement.
L’auteur, Grégoire Andreo Raynaud, étudiant en sociolinguistique à l’université Paul-Valéry Montpellier 3, a été choisi car extérieur au milieu occitan. Lui qui ne parlait pas la langue a ressenti la nécessité de s’engager dans son apprentissage, ce qui a joué un rôle symbolique facilitateur dans les entretiens avec les acteurs.
L’ouvrage comprend 4 parties. Dans la première, l’auteur définit un certain nombre de concepts, dans le champ des politiques linguistiques, et expose sa méthodologie. L’objectif n’était pas l’étude de la langue occitane, mais celle des pratiques langagières, sociales et politiques, et l’influence des idéologies culturelles et linguistiques sur les pratiques, pratiques qui s’articulent autour de ce qui est désigné par les acteurs institutionnels (et par les militants) comme « occitan », ici le languedocien parlé en région administrative Occitanie. La dénomination « occitan » est le lieu d’enjeux sociopolitiques : c’est plutôt le terme « patois » qui est utilisé par les « primo-locuteurs » ou locuteurs « naturels », « occitan » étant utilisé par les néo-locuteurs, locuteurs d’occitan langue seconde.
Par l’observation des pratiques dans le but de comprendre les interactions entre les différents niveaux qui influencent une situation glottopolitique particulière, l’auteur souhaite répondre à deux questions : pourquoi la langue occitane est considérée comme un patrimoine à valoriser et quel rôle jouent les Calandretas dans cette valorisation ? Ce projet a requis 3 ans d’enquête auprès des anciens Calandrons (nom donné aux élèves de Calandreta), des Calandrons de 9 et 11 ans, des enseignants (ou regents) et des parents d’élèves, et d’analyse des registres matricules et des fiches d’inscriptions, des discours médiatiques et des discours institutionnels.
Il investigue ensuite, dans une deuxième partie, la notion complexe de patrimonialisation : comment un objet culturel devient patrimoine, en l’occurrence ce qui, selon lui, doit être nommé la « langue-culture occitane » afin que soient pris en compte à la fois les faits linguistiques et les pratiques culturelles (dont la littérature) qui jouent un rôle important pour la légitimation de la langue occitane en tant que « langue à part ».
La notion est largement discutée en parallèle avec celles de normalisation et de revitalisation. Alors que la revitalisation est une quête de « redonner vie » à une pratique langagière ou culturelle supposée disparue et que la normalisation a une visée résolument politique, la patrimonialisation souscrit à l’idéologie de préservation de la diversité linguistique en vue de sa transmission institutionnelle comme patrimoine commun en remplacement de la transmission familiale. Caractérisée par une « dépolitisation » en ce qu’elle conduit à une « suspension du conflit diglossique », la patrimonialisation se présente comme un compromis. Voir Alén Garabato C. et Boyer H. (2020), Le marché et la langue…
Le positionnement des Calandretas dans cette idéologie de la patrimonialisation est saisi à travers l’histoire de la réflexion sur l’enseignement de la langue depuis le Félibrige, puis portée par l’Institut d’Études occitanes qui milite pour l’enseignement de la langue sous statut public. Une revendication qui ne trouvera pas son issue positive, d’où l’idée de créer une école sous contrat associatif avec l’État, soutenue par les collectivités territoriales et par les parents (paiement d’une adhésion et participation aux différentes manifestations festives).
La partie 3 décrit en détail les écoles Calandretas de 3 villes moyennes d’Occitanie disposant d’une Calandreta depuis plus de 20 ans – Carcassonne (Aude), Pamiers (Ariège) et Béziers (Hérault) – les interactions avec les milieux économique et social, et les modes d’appropriation des processus de patrimonialisation par les acteurs des différents territoires. Pour chacune des villes, sont analysés la situation linguistique et les environnements culturel, éducatif et politique au niveau local (départemental et municipal) et les effets de la langue-culture occitane sur le développement économique et social. Malgré des points communs, les trois configurations présentent des différences :
Pamiers est la seule des 3 villes où la langue soit toujours pratiquée, et une vision folklorisante perdure liée à une représentation passéiste. Dans ce contexte rural où les écoles publiques ont fermé, la Calandreta participe à la revitalisation des villages.
À Carcassonne, l’occitan est associé à une culture savante, portée par un tissu militant ancien, qui est exploitée au niveau touristique, la Calandreta étant au cœur de la Cité médiévale.
À Béziers, le tissu associatif et militant dense œuvre à revitaliser la langue sur le plan institutionnel (« patrimonialisation dynamique »), et les Calandretas situées en milieu urbain dans des quartiers prioritaires sont des vecteurs de mixité sociale.
La dernière partie est consacrée à l’appropriation de l’action des Calandretas par les acteurs eux-mêmes – parents d’élèves, élèves, enseignants –, leurs représentations et leurs pratiques.
La transmission de l’occitan n’est pas le critère décisif qui pousse les parents à inscrire leurs enfants en Calandreta, même s’il constitue un plus. Les motivations relèvent souvent de l’intérêt pour le modèle scolaire : l’apprentissage par immersion, la pédagogie Freinet, l’éveil cognitif lié au bilinguisme... Pour certains, ce peut encore être l’attitude vis-à-vis de la vie en société, l’écologie, la diversité culturelle, la laïcité, le respect des différences (choix positif) ou pour d’autres l’évitement de l’enseignement public (choix négatif). La compétence linguistique des parents est relativement faible, souvent passive : la plupart ne parlent pas la langue, mais la comprennent (« occitano-imprégnés »). Les entretiens avec les ex-Calandrons montrent que tous gardent un rapport affectif avec leur scolarité et que même si le lien avec la langue occitane a été rompu, elle peut être parlée lors de retrouvailles avec d’autres locuteurs, ce qui fait de l’occitan une langue de réseau. Les regents jouent un rôle central dans la patrimonialisation de la langue. Leur engagement est d’une autre nature que celle de la première génération occitaniste, en adéquation avec les enjeux sociaux et éducatifs et moins orientée vers l’action militante à caractère politique.
Outre de confirmer certaines conclusions d’études précédentes, l’apport essentiel de l’ouvrage, très touffu, réside dans la mise au jour des différents régimes de patrimonialisation sous lesquels évolue une langue minorisée et l’ambivalence de ce nouveau statut patrimonial : de la « patrimonialisation diglossique » en zone rurale (p. 286) à une patrimonialisation de la langue et de la culture valorisées comme ressources éducative, sociale, économique. Il montre bien comment les Calandretas contribuent au prestige de la langue-culture occitane en lui donnant une visibilité qui sert de support à des initiatives culturelles et économiques au détriment de la valeur d’usage de la langue.
Compte rendu par Françoise Dufour, dans la revue Langage et société 2023/3 (N° 180).
Avis
Aucun commentaire client pour le moment.
 English
English Français
Français Occitan
Occitan