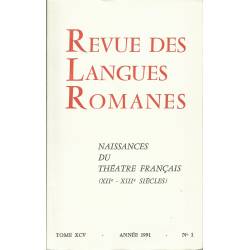Recently added item(s)
Aucun produit
Produit ajouté au panier avec succès
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Revues, Journaux
- Seleccion dau moment
- Livres
- Musica
- Videos - DVD
- Objets
- Revues, Journaux
Liames
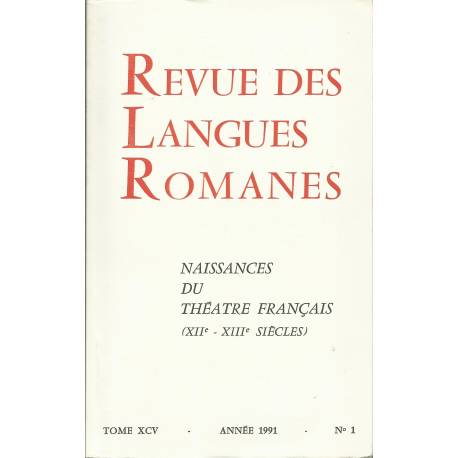 View larger
View larger Revue des Langues Romanes - Tome 95 (1991 n°1)
L-
Used
1 Item
Dins l'estòc
Warning: Last items in stock!
14,50 €
Revue des Langues Romanes - Tome 95 (1991 n°1)
Naissance du Théâtre Français (XIIe - XIIIe siècles)
Data sheet
| Type | Broché |
| Année | 1991 |
| Lenga | Francés + Occitan |
| Pages | 224 |
| Format | 14 x 22 cm |
| Distributeur | PULM |
| Label | Revue des Langues Romanes |
| ISSN | 0223-3711 |
More info
Revue des Langues Romanes - Tome 95 (1991 n°1)
Tome 95-1 de la « Revue des langues romanes » (revue de linguistique, de littérature et de philologie romanes):
"Naissance du Théâtre Français (XIIe - XIIIe siècles)". Première publication de l'année 1991 (PULM).
Revue des Langues Romanes - Tome 95 (1991 n°1)
"Naissance du Théâtre Français (XIIe - XIIIe siècles)"
Études réunies par Jean Dufournet.
La Revue des langues romanes, désormais plus que centenaire, continue à exploiter les riches terrains de la philologie des langues romanes, au sens classique du terme, et du texte littéraire occitan.
Extrait : Michel Rousse : "Le théâtre et les jongleurs", pp. 1-14.
Le théâtre au XIII° siècle, c'est pour nous le drame liturgique du côté de la pratique religieuse, et, dans le domaine profane, quelques noms, Jean Bodel, Adam de la Halle, Rutebeuf; à quoi l'on peut ajouter un ou deux auteurs de textes anonymes comme Courtois d'Arras ou Le Garçon et l'Aveugle. On ne peut que supposer que cette production aux qualités littéraires et théâtrales éminentes, mais qui en cent ans nous propose seulement six textes, a dû s'appuyer sur des conventions, des traditions de jeu dont nous n'avons pas témoignage direct. Jouer une pièce de théâtre suppose un public qui sait reconnaître les raccourcis, les déguisements, les ellipses de temps et de mouvement, les repères qui délimitent un espace, bref un ensemble de règles non écrites mais que l'usage a imposées et qui permettent à des acteurs, en un lieu qui s'adapte aux exigences de leur jeu, de proposer une œuvre en son devenir et en sa concrétisation corporelle et linguistique. Nos auteurs ont certes puisé dans la tradition du drame religieux, leurs sujets mêmes en sont parfois proches, mais il reste que les trois dont les noms nous sont parvenus et dont les œuvres sont les plus achevées s'avouent hautement être jongleurs. Or l'on a quelque peine à relier l'art théâtral et le jongleur, et E. Faral, dans son ouvrage consacré aux jongleurs, tend même à ne les mettre en relation qu'assez tardivement.
Editeur: Presses Universitaires de la Méditerranée (PULM).
Reviews
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
 English
English Français
Français Occitan
Occitan